
Le dessus des mots fascine mais c’est toujours dessous que ça se passe
Jean-Pierre Siméon, La flaque qui brille au retrait de la mer, Éditions Project’Îles
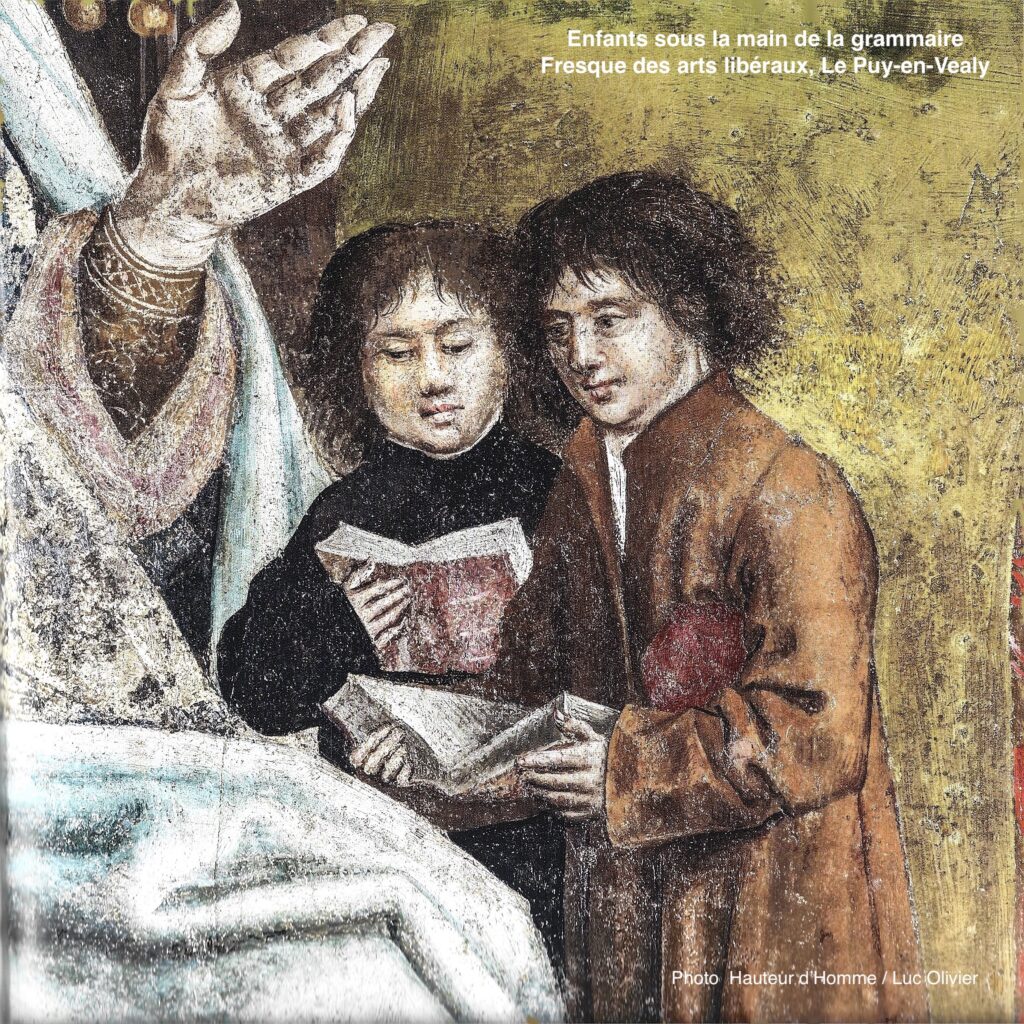
Ce site héberge des ressources nécessaires à la mise en œuvre de La petite fabrique de grammaire du CE2 au CM2 – pour l’instant essentiellement au CE2 et au CM1. Il est toujours en construction mais il est appelé à évoluer et s’enrichir dans les années à venir.
Il complète la publication des ressources pour le niveau CE1 chez Hatier en 2023 en trois ouvrages : un Guide pédagogique, un Fichier photocopiable et Mes livrets de grammaire (une pochette de livrets élèves présentant les activités d’entrainement). Voir la présentation sur le site d’Hatier.
Il s’adosse à l’ouvrage La fabrique de grammaire, paru chez Hatier en septembre 2024. Voir la présentation sur le site d’Hatier.
Ce qu’on peut trouver dans ce site
Ce qu’on peut trouver dans ce site
– des fiches de leçons précises sur l’ensemble des notions grammaticales étudiées à l’école élémentaire, suivies d’exercices pour vérifier la compréhension de la leçon et accompagnées d’un diaporama pour la classe et d’une fiche photocopiable avec les éléments à distribuer aux élèves.
Ces fiches sont regroupées par domaines sous l’onglet « situations d’apprentissage ». Elles sont aussi accessibles sous l’onglet « programmations » dans l’ordre chronologique qui nous semble pertinent.
– des situations d’écriture à visée grammaticale qui permettent de saisir sur le vif les représentations des élèves.
– un ensemble de propositions pour conduire à l’automatisation de l’orthographe : des activités rituelles, des exercices, des jeux de grammaire…
– du matériel pour tester et évaluer les progrès des élèves.
– sous l’onglet « je me forme », des notices sur des notions essentielles.
– des ressources diverses (liste des verbes irréguliers, liste des mots les plus fréquents…)
Voir ici le plan du site.
Principes de la méthode
La méthode que nous proposons n’a pas d’autre but que d’aider les collègues à enseigner et les élèves à apprendre la grammaire en évitant – en limitant – ennui, absence de motivation, faiblesse du réinvestissement…
Pour y parvenir, elle se donne un objectif essentiel : amener les élèves à envisager la langue non pas seulement comme un espace de communication (ils ne nous ont pas attendus pour savoir communiquer) mais aussi comme un ensemble de moyens à disposition, ensemble organisé en système et réglé au fil du temps et des usages, digne d’être observé afin de mieux utiliser ces moyens pour communiquer.
Il en découle quelques principes :
– solliciter la curiosité et l’intelligence des élèves dès l’introduction d’une séquence
On leur soumet d’abord des problèmes de lecture ou d’écriture qu’ils peuvent résoudre mais qui conduisent à s’interroger sur le fonctionnement de la langue. Par exemple, la notion de genre est introduite par des devinettes qui obligent à prendre en considération les marques de féminin.
– accueillir les élèves là où ils en sont et les accompagner au plus près
La programmation très progressive et spiralaire – par exemple pour passer du –s comme « marque qui veut dire plusieurs » à –s comme « marque qui montre l’unité du groupe nominal »
Un soin particulier est apporté à l’introduction des mots spécifiques : autant que possible ils sont rapprochés et distingués des mots de la même famille que les élèves peuvent connaitre (par exemple : « ciseaux » et « proposition incise » qui « coupe » le fil des échanges dans un dialogue).
– adopter une démarche d’enseignement explicite
Les objectifs sont clarifiés et chaque leçon répond à une question. Les différentes manières d’investiguer un corpus et de construire une notion sont explicitées de sorte que les élèves les reconnaissent d’une leçon à l’autre et que peu à peu ils puissent se construire une conscience disciplinaire.
– entretenir le lien avec les usages langagiers (dire, lire, écrire) qui sont le soubassement et la finalité de toute étude de la grammaire
En particulier on propose des situations d’écriture où mettre en œuvre les savoirs appris
– éveiller à la diversité des langues
Contraster les systèmes linguistiques participe d’une meilleure prise de conscience du fonctionnement singulier de sa propre langue.
– donner à l’erreur toute sa place dans le processus d’apprentissage (poser un regard bienveillant sur les tâtonnements)
En particulier des analyses d’erreurs (attribuées à un élève fictif mais fréquemment rencontrées dans les classes) montrent l’erreur comme une occasion offerte à la réflexion.
– développer une évaluation positive.
L’évaluation formelle est pensée en termes de « test de progrès » (un même test est soumis à plusieurs reprises dans l’année : on peut mesurer non pas des lacunes mais les progrès faits puisqu’il n’est pas attendu que la tâche du test soit entièrement réalisée).
En somme, notre projet vise un élève chercheur et un sujet culturel. Il veut former un élève qui observe le fonctionnement de la langue et se pose des questions, qui forme peu à peu des concepts pour décrire ce dont il prend conscience et qui parvient à une vision du système autorisant la comparaison avec d’autres langues.
Il s’adresse aussi à un sujet culturel, capable de curiosité voire d’émerveillement, susceptible d’éprouver étonnement et esprit de conquête, disponible pour remodeler son propre usage de la langue au contact de l’usage que lui soumettent les activités proposées à son intelligence.
Je crois que la grammaire, c’est une voie d’accès à la beauté.
Quand on parle, quand on lit ou quand on écrit, on sent bien si on a fait une belle phrase ou si on est en train d’en lire une. On est capable de reconnaitre une belle tournure ou un beau style.
Mais quand on fait de la grammaire, on a accès à une autre dimension de la beauté de la langue. Faire de la grammaire, c’est la décortiquer, regarder comment elle est faite, la voir toute nue, en quelque sorte. Et c’est là que c’est merveilleux, parce qu’on se dit : « Comme c’est bien fait, qu’est-ce que c’est bien fichu ! »
Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, Gallimard
Deux témoignages
Une professeure des écoles qui a suivi nos propositions témoigne : « Ce qu’il y a de sûr, c’est que mes élèves ont un intérêt certain pour l’étude de la langue. » Voir ici.
Et une professeure de lycée : « Certaines propositions m’aident bien à reprendre les bases pour mes lycéens en difficulté. C’est solide et c’est clair. »